mar 20 janv 2026
sam 24 janv 2026

Réserver

EXIT [Toute sortie est définitive]
ATTENTION ! NOUVELLE GÉNÉRATION
TEXTE ALISON COSSON
MISE EN SCÈNE MARA BIJELJAC
mer 21 janv 2026
ven 23 janv 2026

Réserver

NOSTALGIE DU RÉCONFORT
ATTENTION ! NOUVELLE GÉNÉRATION
TEXTE ET MISE EN SCÈNE MATTHIEU DANDREAU
mar 31 mars 2026
jeu 02 avr 2026

Réserver

LES FRÈRES SAGOT
TEXTE JULES SAGOT, LUIS SAGOT
MISE EN SCÈNE JULES SAGOT
ven 22 mai 2026
sam 23 mai 2026

Réserver

COMMENCER À EXISTER
FESTIVAL MI/MI
UN SPECTACLE DE DAVID GAUCHARD, STEFAN KINSMAN ET MARTIN PALISSE
dim 24 mai 2026
lun 25 mai 2026
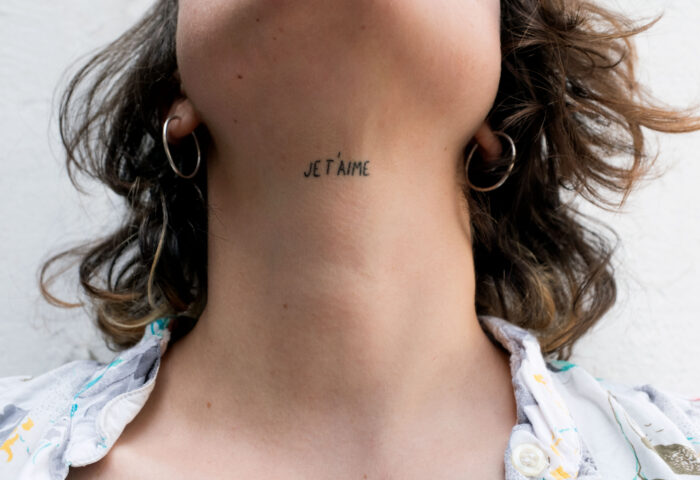
Réserver
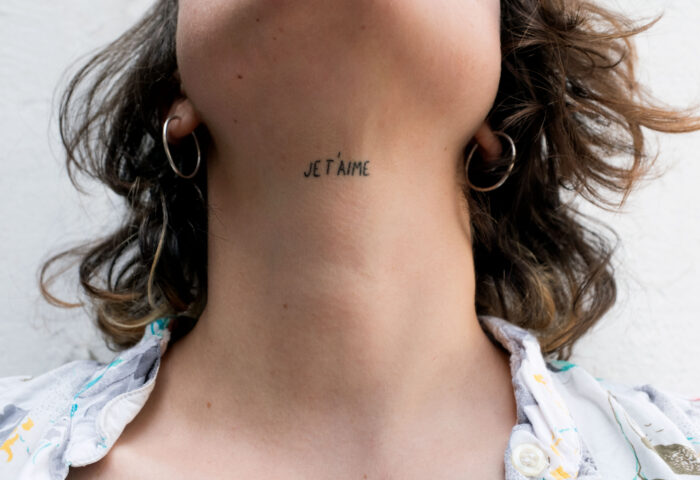
LA CERISAIE
FESTIVAL MI/MI
D’ANTON TCHEKHOV
MISE EN SCÈNE AURÉLIE VAN DEN DAELE
Voir la suite









